 
|
Le plan de paysage entrepris dans la vallée de saint-Amarin afin de réouvrir les perspectives par le défrichage est aujourd'hui une belle réussite. Soutenue par diverses collectivités, l'association Agriculture et Paysage a lancé une nouvelle dynamique dans la vallée entrainant dans son sillage de nombreux agriculteurs. Reste à confirmer la réelle viabilité économique d'une telle opération qui reste encore fortement subventionnée. Cependant, une autre source de revenus est en vue d'être développée : l'association espère bien récompenser ses efforts dans la mise en valeur des paysages par la promotion, auprès des habitants de la vallée, des produits du terroir ... |
Les archives disponibles : |
 |
 |
| |
|
 Adieu fougère, genêt, bouleau et ronce : les élus et les agriculteurs de la vallée de Saint-Amarin
sont bien décidés à faire le ménage dans les paysages
ébouriffés et chevelus qui désespèrent touristes et
autochtones. Chèvres défricheuses, machines et huile
de coude, sont appelés à la rescousse du plan paysage.
Un plan inscrit dans la durée, et qui devra « nourrir
son homme ». Objectif à atteindre, faute de quoi,
fougère et consorts se feront fort de reconquérir vite
fait leur territoire.
Adieu fougère, genêt, bouleau et ronce : les élus et les agriculteurs de la vallée de Saint-Amarin
sont bien décidés à faire le ménage dans les paysages
ébouriffés et chevelus qui désespèrent touristes et
autochtones. Chèvres défricheuses, machines et huile
de coude, sont appelés à la rescousse du plan paysage.
Un plan inscrit dans la durée, et qui devra « nourrir
son homme ». Objectif à atteindre, faute de quoi,
fougère et consorts se feront fort de reconquérir vite
fait leur territoire.
L'opération en cours programmée sur 406 ha et
sur trois ans (43 sites, 29 exploitants) veut stopper
et anéantir les friches afin de les transformer en zones
de pâturages. Agriculteurs et collectivités locales
ont commencé à faire le ménage. Mais un ménage réfléchi
et renouvelable dans le temps ; pas question d'une
tornade verte, tonitruante, mais sans lendemain. Le
grand remue-ménage s'appuie sur la solidarité entre
collectivités locales et milieux agricoles.
Entente
autour d'un patrimoine commun Jadis les paysages
de la vallée de Saint-Amarin ne faisaient guère parler
d'eux. Leur entretien allait de soi. Ils n'étaient pas
pièce rapportée ; l'agriculture s'imposait en tant
qu'activité d'appoint pour les habitants en majorité
occupés dans l'industrie textile. Le moindre brin d'herbe
était alors jalousé et chaque centimètre carré de pâturage
se voyait transformé en lait. Niveau et modes de vie
aidant, la faux fut à partir des années 60, remisée
dans le grenier de grand-père, les vaches partirent
à l'abattoir et l'étable devint garage. La brindille
libérée de ses « bourreaux » s'encanailla,
grignota prés et collines avant de s'imposer à son aise
en une inextricable toison ; d'autres terrains
agricoles étaient livrés à l'urbanisation (les zones
de chalets étaient à la mode), d'autres servirent de
plates-bandes à résineux. La tentative actuelle
de réhabilitation des friches et des espaces agricoles
a eu un précédent. Les anciennes générations parties
à la retraite, l'on avait vu de jeunes agriculteurs
« soixante -huitards » se lancer dans l'aventure.
Incompris par les élus locaux et isolés, bien peu de
ces chevriers tinrent le coup devant les réalités climatiques,
économiques et humaines. Au finish, un bilan défrichement,
globalement mitigé. La relance Des
rescapés de ce retour à la terre, il y en eut cependant.
Ce sont d'ailleurs eux, qui, avec les enfants d'agriculteurs
traditionnels, ont su apporter la dynamique actuelle,
et trouver la confiance des élus. Cette relève tardive
mais réelle, a sans doute, tiré à tout le monde, une
belle épine du pied. Résultat d'un climat de confiance
installé au cours de plusieurs années de réflexion.
La prise de conscience naquit en 1990-91 lors des « états
généraux » du canton, et s'amplifia à l'élaboration
de la charte pour le développement de la vallée (1995). Depuis
lors, les agriculteurs dans leur majorité, n'étaient
plus vus comme des empêcheurs de tourner en rond ou
comme des agents immobiliers en puissance . Cette convergence
de vues déboucha en juin 96 sur la création de l'association
« agriculture et paysages dans la vallée de Saint-Amarin ».
Présidée par Claude Schoeffel de Fellering, par ailleurs
président du Centre départemental des jeunes agriculteurs ;
elle est composée de six paysans et de trois élus du
district (dont son président M. Egler). Après une année
d'existence, cette association fait déjà preuve d'engageantes
dispositions. Une visite sur les sites en cours de réhabilitation
(Mitzach, Mollau, Storckensohn, Fellering) , la dégustation
des produits agricoles locaux (fromages, charcuterie),
et l'assemblée générale tenue à Wesserling, ont participé
à ce constat. Pour parvenir à rouvrir les espaces
et à les rendre à la vie pastorale, un arsenal de mesures
est engagé par l'association, en partenariat avec le
district de la vallée, l'Etat, les instances agricoles,
le conseil général, le parc des ballons des Vosges,
etc. Un animateur, Olivier Claude, a été recruté pour
trois ans, du matériel est acquis avec les CUMA de la
Thur et de la haute-Thur (moto faucheuses avec broyeur,
débroussailleuses à dos) ; un engin de débroussaillement
du département est entré en action (une centaine d'hectares
concernés), un groupement d'employeurs est formé en
vue d'embaucher huit agriculteurs ; une équipe
« d'emplois verts » pilotée par le district
est par ailleurs en fonction. Une activité d'élevage Les
zones reconquises nécessiteront pour leur entretien,
un accroissement du cheptel (dossier en cours de montage
pour l'achat de 64 bovins, 135 caprins, 4 chevaux),
et par ricochet, la création de nouvelles étables d'hivernage.
L'association a en outre lancé des actions de visites
et d'accueil de groupes sur le thème du paysage, des
commandes groupées de clôtures et de semences, et un
programme de remplacement des baignoires-abreuvoirs,
par des fontaines taillées dans des troncs d'arbres. Pour
être crédibles, ces opérations devront générer un revenu.
C'est ainsi que différentes pistes pour valoriser les
produits sont à l'étude : un marché paysan, point
d'accueil et de vente directe à la ferme du parc de
Wesserling, un autre circuit de commercialisation...
Notre premier défi a été la mise en place des structures,
il est atteint, c'est, estima Claude Schoeffel, le début
d'une lame de fond pour la vallée ». Autant dire
que la marée verte, qui est monté haut sur les collines
tout en déferlant sur les villages, n'a désormais plus
qu'à bien se tenir.
P.G.
© Archives des Dernières Nouvelles D'Alsace, 1999
|
|
 |
 |
| |
|
 Un Multrac 120, engin de
défrichement spécialisé, sème la terreur dans les colonies
de fougères,
Un Multrac 120, engin de
défrichement spécialisé, sème la terreur dans les colonies
de fougères,
de genêts tapissant la vallée de Saint-Amarin.
Les
agriculteurs de la vallée de Saint-Amarin ont dit chiche
au conseil général. Le plan paysager de la vallée dont
les prémices remontent aux Etats généraux du canton
(1991), et qui a été poursuivi en 1995 par le district
et par le parc régional des ballons des Vosges, est
devenu leur affaire. Non pour jouer aux jardiniers d'agrément
et figurer dans les magazines, mais dans le but de développer
leur exploitation. L'association « agriculture
et paysage de la vallée de Saint-Amarin » en place
depuis un an (DNA du 11.7.), a donc monté un projet
global assorti de dossiers, en vue de permette à terme
aux agriculteurs, de vivre des fruits de la terre reconquise. Têtu
comme un Multrac... L'ensemble des partenaires
du plan intercommunal paysager se sont mis à la tache
en mettant en oeuvre, moyens humains et matériels. Un
des plus spectaculaires est ce Multrac 120 dont nous
avons apprécié lors d'une démonstration sur les pentes
de Fellering (*), l' irrésistible efficacité :
genêts, aubépine, arbustes passent à la moulinette ;
hachés menu, pulvérisés, broyés sans rémission. De la
pointe à la racine. Des chaînes placées à l'avant de
la machine dégrossissent le travail, relayées par un
broyeur à axe vertical ; et quand le Multrac recule,
il plante des crocs en pointes de carbure de 5 à 10
cm qui labourent le sol pour extraire les racines. Autant
dire que le terrain sera bientôt apte à recevoir les
semences des graminées qui recréeront le pâturage. Suite
au dossier élaboré par « agriculture et paysage »,
une commission du conseil général a été amenée l'automne
dernier, à choisir parmi cinq propositions. C'est celle
d'un constructeur suisse, la société Mahler qui a remporté
la palme. Des pentes de plus de 50% L'engin
retenu, été élaboré en coopération avec un groupement
d'intérêt économique de Haute-Savoie, fort de 15 ans
d'expérience avec de telles machines. Le Multrac doté
d'un moteur développant 120 chevaux, est pratiquement
un engin fait sur mesure, une bête qui a les qualités
et le comportement d'un tracteur forestier et d'un engin
de travaux publics. Quatre roues motrices, et directrices,
un centre de gravité très bas, une transmission hydrostatique
aux outils, en font un outil redoutable capable de crapahuter
dans des pentes de plus de 50% et d'escalader comme
une fleur, rochers, et arbres barrant le sol. La machine
représente un investissement de 1,1 MF qui a été payé
par le conseil général, l'Etat et la communauté européenne. Le
Multrac est appelé à oeuvrer en priorité dans la vallée
de Saint-Amarin (une centaine d'hectares concernés,
sur les 400 que comporte le plan de défrichement 1996-98)),
mais il étendra également son rayon d'action dans les
autres secteurs des Vosges haut-rhinoises concernés
par le problème de la friche.
Pascal Gerrer
La présentation a été faite par M.M. Jean-Paul Schmitt
président de la commission de l'environnement au conseil
général, et par Pierre Egler conseiller général et président
du district de la vallée de Saint-Amarin, en présence
du sous-préfet de Thann, de conseillers généraux de
vallées voisines, de responsables des services agricoles,
du parc des ballons, de l'ONF, de maires et d'élus locaux.
© Archives des Dernières Nouvelles D'Alsace, 1999
|
|
 |
 |
| |
|
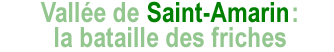 Dans la montagne vosgienne alsacienne, la guerre
à l'enfrichement a été déclarée. 15 000 hectares
font aujourd'hui l'objet d'opérations de reconquête.
Objectif : recréer de nouveaux pâturages et améliorer
le cadre de vie des habitants. Exemple dans la vallée
de Saint-Amarin.
Dans la montagne vosgienne alsacienne, la guerre
à l'enfrichement a été déclarée. 15 000 hectares
font aujourd'hui l'objet d'opérations de reconquête.
Objectif : recréer de nouveaux pâturages et améliorer
le cadre de vie des habitants. Exemple dans la vallée
de Saint-Amarin.
Le problème est le même du nord au sud de la région.
Aucun secteur du massif vosgien n'est épargné. Partout,
la forêt et les broussailles gagnent du terrain. Les
prairies abandonnées par le recul de l'agriculture sont
progressivement envahies et les fonds de vallée se réduisent
comme peau de chagrin. Par endroits, le phénomène prend
même des proportions alarmantes. Comme par exemple à
Wildenstein, dans la vallée de Saint-Amarin, où la forêt
a rejoint les maisons. Résultat : les habitants
ont perdu quatre heures de soleil par jour. Ici,
plus qu'ailleurs, le problème méritait d'être pris à
bras le corps. La vallée de la Thur est en effet l'une
des plus étroites de la région. Celle aussi où les pentes
sont parmi les plus escarpées et où les agriculteurs
sont confrontés à l'environnement le plus difficile.
C'est, du coup, celle qui a été la première à réagir
et « où la réflexion sur les rapports entre l'agriculture,
la gestion de l'espace et l'environnement a été poussée
le plus loin », estime Guy Peterschmitt, chef du
service de l'économie agricole de la direction départementale
de l'agriculture et de la forêt du Haut-Rhin. Elle a
d'ailleurs à ce titre été retenue comme site expérimental
par l'organisme Mairie-Conseils. Etude paysagère Les
quinze communes du district de la vallée de Saint-Amarin
ont engagé le combat contre les friches dès 1994. D'abord
en réalisant une étude paysagère destinée à définir
les espaces à entretenir ou à réouvrir en priorité.
Puis en élaborant un plan de bataille, mis en oeuvre
par les élus et surtout les exploitants du canton réunis
au sein de l'Association agriculture et paysage. Pour
eux en effet, « il était vital de rendre aux agriculteurs
leurs 350 hectares de prairies aujourd'hui recouvertes
par les friches », explique Claude Schoeffel, président
de l'association et, accessoirement, du centre départemental
des jeunes agriculteurs. 29 exploitants de la
vallée ont donc accepté de devenir de véritables prestataires
de service. C'est à eux qu'a été confiée la mission
de défricher en trois ans plus de 400 hectares de terrains
communaux situés sur 43 sites différents. Une opération
financée à hauteur de 70 % par l'Etat et la Région
au titre de l'amélioration pastorale qui a déjà permis
de regagner une centaine d'hectares sur la forêt. Ces
terrains ont aussitôt été convertis en pâturages. Il
n'y a en effet rien de tel que les animaux pour entretenir
les prairies. Encore faut-il qu'ils soient en nombre
suffisant. Les agriculteurs engagés dans le programme
ont du coup agrandi leurs élevages. Le cheptel de la
vallée compte d'ores et déjà 64 vaches, 135 chèvres,
10 moutons et quatre chevaux de plus. Résultat :
les exploitants, qui doivent faire face à un surcroît
de travail, ont constitué un groupement d'employeurs.
Parallèlement, dix emplois verts (CES) ont été créés
par le district. Ces dispositions, par les investissements
qu'elles supposent en matériel, en animaux et en bâtiments
d'élevage, coûtent aux agriculteurs au moins autant
sinon plus qu'elles ne rapportent. C'est pourquoi le
complément de revenu fourni par les mesures agro-environnementales
est pour eux le bienvenu. Mesures agri- environnementales En
écho à la proposition de la Communauté européenne de
participer au financement de programmes qui orientent
l'agriculture vers une meilleure prise en compte de
l'environnement, le parc naturel régional du ballon
des Vosges, le conseil général, la région, la DDAF,
la chambre d'agriculture et les syndicats agricoles
ont en effet engagé un vaste projet de gestion des espaces
ouverts en montagne vosgienne haut-rhinoise. En clair :
ils rémunèrent les agriculteurs qui acceptent, en vertu
d'un cahier des charges très strict, d'entretenir les
territoires de montagne voire de reconstituer leurs
équilibres biologiques. Aujourd'hui, près de
10 000 hectares situées sur le territoire des 70
communes de montagne haut-rhinoises sont concernés par
le programme. Dont 1 600 dans la vallée de la Thur.
49 agriculteurs du district se sont engagés par contrat
à les débarrasser des fougères, genêts et autres ronces
qui les encombrent. Avec l'aide, s'il le faut, d'un
tracteur spécial acheté plus d'un million de francs
par le conseil général du Haut-Rhin, mais dont l'utilisation
leur est facturée. D'ici trois ou quatre ans,
2 000 hectares de la vallée auront donc été reconquis.
Au profit de l'activité agricole et du cadre de vie
des habitants. La démarche engagée commence d'ailleurs
à les faire réfléchir. « Il y a un véritable effet
boule de neige, constate Olivier Claude, l'animateur
d'Agriculture et paysage. Lorsque les agriculteurs défrichent
de grandes surfaces, les petits propriétaires installés
en périphérie des communes se mettent eux aussi à entretenir
leurs parcelles ».
|
|
 Le vaste programme de reconquête des paysages
devrait permettre de conforter l'activité agricole dans
la vallée de Saint-Amarin. Déjà, les premiers effets
se font sentir. Témoignages.
Le vaste programme de reconquête des paysages
devrait permettre de conforter l'activité agricole dans
la vallée de Saint-Amarin. Déjà, les premiers effets
se font sentir. Témoignages.
Le défrichage, François Schirck connaît bien.
Depuis qu'il s'est installé avec un petit troupeau de
chèvres sur les sommets de Mollau, en 1978, il pratique
ce travail au quotidien. Comme les autres agriculteurs
de la vallée, il lui faut aménager des espaces de pâture
pour ses 19 vaches laitières. Grâce à la combinaison
des mesures agri-environnementales, des fonds structurels
européens et des aides du fond de gestion de l'espace
rural, « là où on faisait des petites clairières,
on fait maintenant des parcs de plusieurs hectares ». Une
centaine de chèvres François Schirck a pû
bénéficier de l'aide du salarié engagé par le groupement
d'employeurs qu'il a constitué avec sept autres exploitants
de la vallée. Il a pu surtout acheter une centaine de
chèvres dans l'unique but de défricher ses terrains.
« Maintenant, explique-t-il, on va pouvoir développer
le troupeau. Il permettra d'ouvrir des prairies pour
les vaches ». Indispensable pour cet éleveur qui
ne vit que de la vente de ses fromages. A terme, espère-t-il,
il pourra commercialiser ses cabris. « Cela permettrait
de recréer le lien entre les consommateurs de la vallée
et leur environnement. En consommant des produits du
terroir, ils contribueront à l'entretien de leur territoire ». Les
exploitants du district ne raisonnent en effet pas en
marge brute. « Nous n'avons pas une optique technico-économique
mais une approche globale de notre activité »,
confirme Claude Schoeffel, exploitant à Fellering et
président d'Agriculture et paysage. « Nous avons
une activité à deux doigts du bio. Nous vivons dans
un milieu qui nous fait vivre et notre seule question
est : comment continuer à en vivre ? »
Surtout lorsque, comme ici, les fonds de vallées sont
peu à peu envahis par l'urbanisation et que les agriculteurs
sont repoussés dans la montagne. Fernand Hoffner
en sait quelque chose. Cet exploitant de Fellering,
qui préside le groupement d'employeurs, s'apprête en
effet à perdre une de ses plus belles prairies de fauche.
Pour lui, l'extension du village est dans l'ordre des
choses. Du coup, il défriche des landes perchées dans
la montagne à l'aide du gyrobroyeur acheté en CUMA*,
comme le prévoit le contrat de cinq ans qu'il a conclu
avec la commune grâce aux mesures agri-environnementales.
D'ailleurs, sans elles, il ne serait pas là. « Je
me suis installé il y a trois ans parce que je savais
que je pourrais bénéficier de cette aide ». Elle
permet déjà aux agriculteurs de développer leurs exploitations.
Et donc, à long terme, d'espérer une augmentation de
leur revenu -si toutefois les mesures sont maintenues.
En attendant, elles apportent du sang neuf. Trois jeunes
agriculteurs sont d'ores et déjà en cours d'installation.
Odile Weiss
* Coopérative d'utilisation du matériel agricole
© Archives des Dernières Nouvelles D'Alsace, 1999
|
|
 |
 |
| |
|
 «Cette année nous avons passé la 2e vitesse, la
3e et je crois que la 4e n'est pas loin ». Claude
Schoeffel, président de l'association «Agriculture et
Paysages de la vallée de Saint-Amarin» qui a tenu son
assemblée générale à la ferme du Bergenbach au-dessus
d'Oderen, a le sourire.
«Cette année nous avons passé la 2e vitesse, la
3e et je crois que la 4e n'est pas loin ». Claude
Schoeffel, président de l'association «Agriculture et
Paysages de la vallée de Saint-Amarin» qui a tenu son
assemblée générale à la ferme du Bergenbach au-dessus
d'Oderen, a le sourire.
Le travail de défrichage et de remise en valeur des
anciens pâturages a en effet véritablement chaussé les
bottes de sept lieues, à un point tel que la discussion
porta un moment sur la nécessité impérieuse de préserver
une frange de buissons entre la forêt et le pâturage
reconquis de haute lutte : machine défricheuse
suspend ton vol... L'an dernier, programmer
357 ha de zone à travailler était considéré comme
le premier défi à relever. Il a été au delà de toute
espérance puisqu'à ce sont 457 ha (46 sites), qui
sont touchés dont 100 ha ont déjà été entièrement
réhabilités. 31 agriculteurs se sont alliés dans cette
opération. Huit d'entre eux ont créée un groupement
d'employeurs; ils ont prévu d'engager un second salarié
en vue de répondre au travail supplémentaire que nécessite
la prise en compte des 123 bovins, des 135 chèvres et
des 30 porcs venus agrandir le cheptel. «Agriculture
et paysages» qui bénéficie il est vrai d'un animateur
dont l'efficacité rime avec la compétence, a pris le
taureau par toutes ces cornes. Et mène de front un éventail
d'actions impressionnant. Outre le fait de défricher
et de prévoir l'entretien du pâturage avec des animaux,
l'association a ouvert un dossier en vue de l'écoulement
des produits (en particulier la viande), elle organise
l'accueil de groupes attirés par la renommée nationale
que s'est attirée la vallée dans le domaine de la reconquête
de ses paysages, elle va publier une plaquette de promotion,
a lancé une opération de remplacement des baignoires-abreuvoirs
par des abreuvoirs en troncs d'arbres, centralise des
commandes groupées de produits et mène une réflexion
sur l'usage à faire de la ferme du parc de Wesserling. Pâturer,
mais aussi faucher... « L'association
a mis la 4e et compte aller plus loin. Mais tout cela
n'est pas tombé du ciel» prévint M. Schoeffel. De nombreux
organismes tels le Parc des Ballons, la Chambre d'agriculture,
le Conseil général, apportent du carburant et en apporteront
encore, car d'autres étapes se profilent, d'autres problèmes
sont à prendre en compte. Ainsi celui provoque
par l'installation d'animaux supplémentaires sur les
surfaces dégagées. En été ils seront sur les pâturages,
mais en hiver il faudra les nourrir avec du foin provenant
des prairies de fauche (un ha produit de quoi nourrir
deux vaches en hiver). Sachant que ces surfaces généralement
en fond de vallée ont tendance à s'amenuiser sous la
pression des tentations urbanistiques des élus et des
propriétaires, M. Schoeffel fit en cette année de la
révision de plans d'occupation des sols, appel aux maires
pour qu'ils conservent les prés de fauche. Qu'ils ne
les classent pas en zone urbanisable ! La situation
actuelle est déjà joliment déficitaire. Elle oblige
des paysans à acheter du foin à l'extérieur de la vallée.
Ce qui pèse lourd dans leur budget. Poursuivre dans
cette voie rendrait la situation intenable. Pour trouver
une solution économiquement viable, Claude estime qu'il
«faudra bien trouver des compensations quelque part
comme l'on fait les voisins de La Bresse (ils bénéficient
d'un budget fourrage).» En tout état de cause, souligna
le président d'A et P «nous serons vigilants quant à
la conformité entre plan paysage et le POS». Ce que
l'on pourrait traduire par «défricher oui, mais ne pas
être le dindon de la farce». Claude Schoeffel
qui se réjouit de voir que le travail mené dans la vallée
de Saint-Amarin a été le coup de starter de la nouvelle
politique agricole au niveau du massif vosgien, souhaite
que les collectivités continuent à assurer les financements
afin de rendre irréversible l'opération alors qu'elle
se trouve à mi-chemin. Pour François Tacquard,
conseiller général et vice-président d'Agriculture et
paysages, la force de l'opération réside dans le fait
de conjuguer le projet paysage avec la volonté de vivre
de l'agriculture. Pierre Schmitt, conseiller général
de Ribeauvillé, président de la commission environnement
e agriculture du Conseil général, assura l'association
de son soutien. Guy Peterschmitt (Direction départementale
de l'agriculture) est également d'avis qu'il faut poursuivre
l'action, car pour lui «ce travail est aussi l'opération
dont le rapport qualité-coût est le moins cher par rapport
à ce que j'ai observé ailleurs»; poursuivre pour obtenir
un «plan de développement durable»; l'Alsace étant dit-il
«la seule région à ne pas appliquer un tel plan, et
Saint-Amarin étant l'endroit le plus mûr, la vallée
doit dire, je veux ce plan». Francis
Schirck, membre d'A et P mit l'accent sur la nécessité
de relier le consommateur «à nos aménagements paysagers»,
cela passera par la promotion des produits locaux et
notamment par la mise en oeuvre de la filière viande
sur la base de ce que les agriculteurs de cette vallée
ont fortement soutenu à Lapoutroie. Les produits locaux
(charcuterie, fromages, pain paysan) ont d'ailleurs
pu être largement appréciés par les participants à cette
réunion (maires, délégués des administrations et membres
d'A et P), et cela à la suite d'un circuit dans la ferme
bio-dynamique de Marlène Kapp, de Jacques Simon et de
leur association. Au courant de l'après-midi,
les participants s'étaient rendus sur les hauteurs de
Mitzach. Cette commune est maillot jaune dans le défrichement
de ses pentes. L'adjoint au maire, Bernard Franck avait
détaillé les opérations (fort spectaculaires) dues à
la prise de conscience conjointe des agriculteurs locaux,
de la municipalité et des bénévoles. Soutenus par l'entrée
en action de l'engin départemental, ils ont réapprivoisé
une belle surface de l'ancien pâturage communal à présent
occupé par 80 bêtes appartenant à cinq agriculteurs
jeunes et actifs. La transformation de l'ancienne
ferme du parc de Wesserling en une «maison de l'agriculture
et des paysages de montagne» est un autre gros dossier
auquel l'association A et P s'est attelée soutenue par
le Conseil général propriétaire des lieux. Cette ferme
a permis un premier hivernage collectif d'animaux (80
chèvres, une dizaine de bovins et trois ânes). A l'automne
98 elle accueillera un premier marché paysan, mais à
terme elle deviendra lieu de rencontre, d'échanges et
de promotion. Elle sera par ailleurs une base de départ
vers la découverte des autres fermes de montagne et
des paysages qui sont leur écrin.
© Archives des Dernières Nouvelles D'Alsace, 1999
|
|
 |
 |
| |
|
 Venez déguster toute l'année les produits du
paysage. C'est en quelque sorte l'invitation que vous
lancent quinze jeunes agriculteurs par le biais de leur
premier et tout nouveau dépliant « les produits
de la vallée de la Thur, vente directe à la ferme ».
Venez déguster toute l'année les produits du
paysage. C'est en quelque sorte l'invitation que vous
lancent quinze jeunes agriculteurs par le biais de leur
premier et tout nouveau dépliant « les produits
de la vallée de la Thur, vente directe à la ferme ».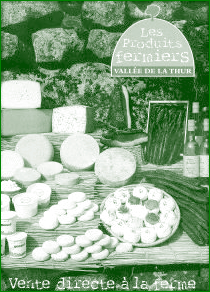
L'agriculture
de montagne, après des années de dépression, s'est ressaisie
dans la vallée de Saint-Amarin. Soutenue par les collectivités
locales, une nouvelle génération de paysans a pris les
problèmes à bras le corps en s'impliquant en première
ligne dans un projet paysager intercommunal dont la
réussite fait école à travers l'hexagone. Plaisir
du goût Faisant d'une pierre deux coups,
et avec la bénédiction des élus, ils se sont donc mués
en jardiniers du paysage. Mais le défrichement et la
réouverture des anciennes chaumes et pâtures, ce n'est
pas uniquement pour le plaisir des yeux. Vains seraient
les efforts s'ils ne visaient une logique économique
devant permettre aux producteurs de vivre autant que
faire se peut, des fruits de la terre. Le retour
en qualité des pâturages rejaillit tout naturellement
sur la qualité des élevages et sur celle des produits
fermiers. Mais il faut les faire connaître, sinon à
quoi bon. Bonifier le paysage Pour
contribuer à la réussite complète de l' opération et
à son installation dans le temps, les quinze fermiers
invitent donc le public à leur rendre régulièrement
visite pour se ravitailler en une foule de produits
naturels. Ils vont des laitages dont bien entendu les
fromages vosgiens (une dizaine de sortes), jusqu'aux
sirops de fleurs et à la laine, en passant par les viandes
et la charcuterie maison. Les coordonnées des quinze
points de vente figurent au dos de cette plaquette qui
est du reste joliment illustrée. Editée avec l'aide
du parc naturel des ballons, du conseil régional, du
district de la vallée de Saint-Amarin, et du programme
leader, elle est disponible auprès de l'association
« agriculture et paysages » dans la maison
du district et à l'office de tourisme à
Saint-Amarin.
© Archives des Dernières Nouvelles D'Alsace, 1999
|
|
|

