 
|
le Parc de Wesserling, un ancien site industriel, constitue un pan important de l'histoire de la vallée de Saint Amarin. Propriété de plusieurs collecivités (le département et le district), celles-ci sont décidées à valoriser ce site à haute valeur patrimoniale en projetant d'y aménager des logements HLM ainsi que des locaux pour diverses associations. Devant ces projets portant atteinte à l'intégrité des bâtiments en place, l'Association de Sauvegarde du Parc milite pour l'inscription du site au titre de la protection des Monuments Historiques. Elle est suivie par la commission régionale chargée du patrimoine historique, la COREPHAE, qui donne un avis favorable pour l'inscription et prend une option pour le classement du site. Les projets immobiliers se trouvent alors réduits à néant, au grand désarroi des élus locaux, foncièrement hostiles à de telles procédures qui imposent de nombreuses contraintes architecturales dans un périmètres de 500 mètres autour du site ... |
Les archives disponibles : |
 |
 |
| |
|
 Wesserling, dans la vallée de la Thur, est le
berceau de l'impression sur étoffes.
L'industrialisation du site remonte à 1762 (Wesserling représentée à travers une lithographie
de Thierry Mieg : photo « LE PAYS »-P.F.).
Wesserling, dans la vallée de la Thur, est le
berceau de l'impression sur étoffes.
L'industrialisation du site remonte à 1762 (Wesserling représentée à travers une lithographie
de Thierry Mieg : photo « LE PAYS »-P.F.).
Dès la fin
du XVIe siècle, les navires en provenance des Indes ramènent vers l'Occident des étoffes de
coton aux coloris chatoyants. Devant leur succès, on essaie très tôt de les imiter en Europe.
Un
an après la révocation de l'Édit de Nantes, en 1686, Louvois interdit les toiles peintes, dont
les spécialistes sont les Huguenots protestants, réfugiés en Suisse, d'où ils approvisionnent
le royaume. Malgré l'interdiction, elles y ont un grand succès. La mode se répand, comme l'atteste
Molière, qui raille son Bourgeois Gentilhomme « vêtu d'indienne » pour jouer au seigneur. La
contrebande devient effrénée et l'usage des toiles peintes est général dès le début du XVIIIe
siècle.
L'abolition est levée par les lettres patentes du roi du 5 septembre 1759. La liberté
de fabrication est rétablie en juillet 1760. Jouy-en-Josas ouvre ses portes la même année.
Deux
ans plus tard, le 20 mai 1762, Jean Mathias Sandherr, le Stettmeister de Colmar, fonde dans
la vallée de la Thur, la manufacture de Wesserling, première manufacture d'indiennes à s'établir
en Alsace, à l'époque où Mulhouse est encore république libre.
L'Alsace, française depuis 1648,
a joué de sa position stratégique.
Wesserling est décorée en 1783, par lettre patente du Roi
Louis XVI, du titre de « Manufacture Royale». A la veille de la Révolution, elle est la plus
importante de France avec celle d'Oberkampf à Jouy-en-Josas.
La Révolution est une opportunité
pour la Manufacture de Wesserling de s'affranchir de l'emprise des princes abbés de Murbach.
Son directeur, Jean Johannot, futur député à la Convention, conduit l'insurrection et la population
de la vallée pour marcher sur Guebwiller.
UN SITE
IDÉAL
Le château de Wesserling, ex-résidence
des princes abbés de Murbach, bâti au sommet d'une moraine glaciaire située au centre du bailliage
de Saint-Amarin, a de quoi intéresser un candidat à l'indiennage. C'est le seul bâtiment existant
et disponible, dans cette contrée, qui soit suffisamment vaste et extensible. Il est situé à
proximité de la route, ancienne et importante voie de relations commerciales entre la Suisse,
l'Allemagne et l'intérieur du royaume, la proximité de la rivière pour le lavage des toiles,
la présence des prés avoisinants pour l'étendage et enfin, la localisation du domaine permettant
de drainer la main-d'oeuvre de toute la vallée expliquent le choix de Wesserling.
A l'époque
où l'industrie textile n'est pas encore mécanisée, cette grande demeure nobiliaire, abandonnée
par ses anciens occupants, offre un cadre commode aux industriels qui veulent s'y installer.
La
fabrication des filés de coton prend son essor sous l'Empire et la Restauration : boom économique
et révolution technique. Le blocus continental, qui empêche l'importation des toiles écrues,
impose le traitement du coton. Le potentiel énergétique de la rivière est sollicité pour actionner
les machines à filer. De cette manière, le travail manuel s'efface devant la mécanique.
PREMIÈRE
FILATURE
MÉCANISÉE
La manufacture de Wesserling est le premier complexe textile à opérer cette mutation
et à pratiquer l'intégration. Dès 1802, elle se dote de la première filature mécanisée, bâtiment
construit sur les bords de la Thur, le long d'un canal usinier, et utilisant l'énergie hydraulique.
Ce bâtiment a été démoli et seul subsiste un porche d'entrée avec une plaque commémorative.
Quatre
ans plus tard, elle se sert de la roue à aubes pour actionner les rouleaux d'impression qui
viennent d'être introduits en France. Le tissage sera absorbé, entre 1825 et 1830, avec l'apparition
des machines à vapeur et des cheminées d'usine qui modifient totalement le paysage. L'établissement
contrôle le cycle complet de fabrication, de la filature à la commercialisation, avec un rayonnement
international jusqu'en Russie, à la cour d'Angleterre et aux États-Unis.
L'activité industrielle
a continué jusqu'à nos jours. Wesserling constitue un site unique sur lequel on peut trouver
l'ensemble des bâtiments retraçant la révolution industrielle : du château aux ateliers, avec
les toits en sheds.
LA CRISE
DU TEXTILE
Cependant Wesserling n'a pas été épargnée par les secousses
du XXe siècle dans l'industrie textile. En 1986, le Département du Haut-Rhin a racheté l'ensemble
des actifs non industriels de la manufacture, afin de les soustraire au morcellement qui semblait
inéluctable après le naufrage de l'empire Boussac.
Certains bâtiments périphériques comme la
chapelle, ainsi que le parc lui-même, ont été remis en valeur, et le patrimoine botanique est
entretenu, tout comme les autres parties de cet immense domaine : le Sée d'Urbès et les berges
de la Thur, qui appartenaient tous aux maîtres du textile.
Mais un tel patrimoine coûte cher
et, pour l'instant, le château, la ferme, les écuries et un grand bâtiment surnommé la barrette
tombent en ruine et sont victimes d'infiltrations.
En juillet 1993, une association de sauvegarde
est née pour défendre ce patrimoine. Elle s'est immédiatement heurtée au Département du Haut-Rhin.
Celui-ci venait de décider d'installer, pour trente millions de francs, un musée textile et
des costumes dans un bâtiment industriel du parc, datant de 1819 (1), alors que l'association
réclame la priorité pour le château, érigé dans sa forme actuelle en 1796, château qu'elle souhaite
voir classé monument historique.
Elle redoute que Wesserling soit « victime d'irrémédiables
destructions comme le château de la Martinsburg de Wettolsheim, où vécut le poète Alfiéri, et
le manoir médiéval d'Angreth à Guebwiller, sacrifié au profit d'un parking».
(1) Le musée a
ouvert ses portes au public le 1er juillet 1996.
© Archives du Journal L'Alsace, 1999
|
|
 |
 |
| |
|
 Le Département a trouvé une solution pour la Barrette,
la villa Gros et la ferme du Parc.
Mais pas encore pour le château, dont la toiture est cependant
en cours de réfection (les travaux de réfection de la toiture du château ont commencé par un grand
nettoyage : photos « L'ALSACE »- E.A).
Le Département a trouvé une solution pour la Barrette,
la villa Gros et la ferme du Parc.
Mais pas encore pour le château, dont la toiture est cependant
en cours de réfection (les travaux de réfection de la toiture du château ont commencé par un grand
nettoyage : photos « L'ALSACE »- E.A).
Le conseiller général Pierre Egler et les services départementaux ont
exposé vendredi soir les grandes lignes de la réhabilitation du parc de Wesserling aux vice-présidents
du district de Saint-Amarin et à la municipalité d'Husseren-Wesserling.
Une avant-première,
avant la présentation lundi au Département, du projet d'aménagement des bâtiments.
Le dossier
le plus avancé est pour l'instant la restructuration de la « Barrette».
L'ADAUHR, le bureau
départemental d'aménagement, propose de reconvertir l'ancien bâtiment industriel, long de 143
mètres en logements HLM.
DÉMOLITION
La « Barrette » dans son état actuel offre une possibilité
de « 60 logements, soit 200 personnes, 100 voitures, 80 enfants », selon l'étude. Pour les responsables
du Département, c'est trop. « Un tel chiffre entraînerait un risque de dénaturation du parc
et des nuisances », admet André Heimburger, directeur architecte du Département. Afin d'éviter
cet écueil, et pour limiter les investissements, l'ADAUHR préconise la réhabilitation de 20
à 25 logements seulement, avec comme conséquence directe, la démolition d'une partie de l'édifice.
« Trois des cinq parties du bâtiment devront être abattues » prévient Pierre Egler.
Les deux
bâtisses de la partie haute vers le château et un morceau de la partie basse vers la RN 66 devraient
être démolies dès le mois de septembre si le dossier est accepté par l'assemblée départementale.
Seul le corps central, la partie la plus ancienne, qui date de 1785, sera conservé. Les autres
parties ont été ajoutées à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe.
La maîtrise d'ouvrage du chantier
sera confiée à l'Office public départemental des HLM, « Espace habitat 68». Le coût de la réhabilitation
est estimé à 6000 F le mètre carré. « Soit environ 5 millions pour 1200 m² concernés » précise
le conseiller général.
HALTE-GARDERIE
La halte-garderie des « Thur'Lutins » ne sera plus hébergée
dans la partie basse de la barrette. M. Egler a annoncé qu'elle sera installée dans la maison
Gros (patron de la Manufacture d'impression, qui y a habité jusqu'en 1938), derrière le temple.
Le Département, propriétaire de la villa, est prêt à faire l'échange avec le district de Saint-Amarin,
propriétaire de la maison Hug, située juste en face.
Reconnaissant qu'au départ il était contre
cette solution, le président du district a expliqué ce choix par une question de coût d'aménagement,
qui atteindrait près de 2,5 millions.
« La maison Gros présente plusieurs avantages : ses abords
peuvent être clos pour la sécurité des enfants et une possibilité d'extension avec l'aménagement
du 3e étage. Mais dans un premier temps, seuls deux niveaux seront aménagés », indique André
Heimburger.
« Elle est aussi plus ensoleillée que la barrette. C'est une belle maison pour les
enfants » observe la présidente des Thur'Lutins, Mme Muller avec satisfaction.
Le conseil de
district, prévu fin juin, se prononcera sur le sujet, afin que la structure « petite enfance
» puisse monter rapidement les dossiers de financement.
Avec les logements HLM et la halte-garderie,
deux bâtiments du parc de Wesserling ont trouvé une nouvelle vocation.
QUID DU CHÂTEAU
Les anciennes
écuries du château, qu'un particulier transforme en gîte équestre, ont également un nouvel avenir,
tout comme la ferme du parc. « Les jeunes et dynamiques agriculteurs de la vallée veulent en
faire une ferme découverte avec un point de vente des produits du terroir et la possibilité
d'accueillir des vaches pour l'hiver » rapporte Pierre Egler. Reste à trouver un financement.
Car ni la Région, ni la Département ne disposent de lignes de crédit pour ce type de projet.
Et
le château ? Alors que tout autour de lui les projets d'aménagement fleurissent, il fait plutôt
pâle figure. Les travaux de réfection de sa toiture, dont le coût s'élève à 3,3 millions, ont
commencé. Ils seront suivis par la rénovation des fenêtres et des volets. Mais pour lui quelle
destination va-t-on trouver ? Les projets les plus fous ont été envisagés, mais aucun pour l'heure
n'a été retenu. |
 Le voeu des responsables des Thur'Lutins est exhaussé
: la halte-garderie sera installée dans l'une des deux villas du parc, la villa Gros. Le voeu des responsables des Thur'Lutins est exhaussé
: la halte-garderie sera installée dans l'une des deux villas du parc, la villa Gros. |
 Le bureau
d'aménagement du Département, l'ADAUHR, propose de démolir toute la partie haute de la Barrette,
au premier plan. Le bureau
d'aménagement du Département, l'ADAUHR, propose de démolir toute la partie haute de la Barrette,
au premier plan. |
© Archives du Journal L'Alsace, 1999
|
|
 |
 |
| |
|
 L'entrée du parc dans le patrimoine des Monuments historiques
est engagée.
Pour Pierre Egler, c'est « une catastrophe », pour l'association de sauvegarde,
« une grande victoire» (La Barrette, le plus long bâtiment du parc,
a abrité les premiers ateliers de la manufacture, au 18e siècle : photo « L'ALSACE » - P. F.).
L'entrée du parc dans le patrimoine des Monuments historiques
est engagée.
Pour Pierre Egler, c'est « une catastrophe », pour l'association de sauvegarde,
« une grande victoire» (La Barrette, le plus long bâtiment du parc,
a abrité les premiers ateliers de la manufacture, au 18e siècle : photo « L'ALSACE » - P. F.).
La commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnographique
(COREPHAE) a décidé à l'unanimité moins une voix (celle de Pierre Egler), jeudi à Strasbourg,
de proposer l'inscription du parc de Wesserling et de ses bâtiments au titre de la protection
des monuments historiques.
Présidée par le préfet de Région, Patrice Magnier, cette commission
est composée de dix fonctionnaires de l'État, de huit élus et de quatre représentants d'associations.
Elle est une étape obligée pour le classement d'un patrimoine.
Le rapporteur du dossier était
le professeur Bischoff, universitaire et président de la société d'histoire de Thann-Guebwiller
qui s'est montré enthousiaste devant la qualité du site de Wesserling. Un enthousiasme partagé
par Pierre Fluck, professeur à l'Université de Haute-Alsace, directeur du centre de recherches
sur les sciences, les arts et les techniques, qui a souligné que le parc de Wesserling est «
la plus extraordinaire agglomération d'architectures industrielles en Alsace, avec des manufactures
du 18e siècle, des habitats patronaux et ouvriers, des usines du 19e et du 20e siècle, des infrastructures
énergétiques et des équipements sociaux» (1).
Plusieurs intervenants ont tenu à féliciter le
département du Haut-Rhin pour le soin qu'il a apporté depuis dix ans à la préservation des lieux.
Un peu de baume au coeur de Pierre Egler, qui allait ensuite se sentir bien isolé dans la discussion...
François
Tacquard, invité en tant que représentant de l'association de sauvegarde, a mis l'accent sur
la fierté et la notoriété qu'apporterait un classement.
Relevant que le site est d'ores et déjà
« un véritable écomusée vivant », il a souligné que la protection du parc permettrait de développer
un parcours historique et touristique. « Les sites les plus visités en Alsace et en France sont
tous classés », a-t-il noté. « Ce serait une chance pour Wesserling.»
MM. STEIGER
ET EGLER CONTRE
Le
maire de Husseren-Wesserling, Bernard Steiger ne partage pas cet avis. Invité lui aussi à s'exprimer
sans pouvoir participer au vote, il s'est prononcé contre des mesures de protection venant de
la part de l'État, à cause des contraintes.
Pierre Egler, qui représentait le département du
Haut-Rhin, propriétaire du parc, a redit que le contrôle de l'État serait un handicap majeur,
non seulement pour la réhabilitation de la Barrette, mais également pour le château et pour
tous les riverains du parc jusqu'à 500 mètres. « Le rayon de protection ira jusqu'à la mairie
de Husseren et jusqu'au garage Sovra à Fellering », a insisté M. Egler. « Il englobera la piscine
et l'usine, ce sera une catastrophe pour le parc et pour les trois communes concernées.»
Le
deuxième vote n'a pas arrangé les affaires du département, puisque la commission a proposé à
une très forte majorité le classement par le ministère de la culture de l'ensemble du site de
Wesserling. C'est un cran supplémentaire par rapport à une simple inscription.
Plusieurs membres
de la commission se sont abstenus sur ce point, dont l'architecte en chef des Bâtiments de France
dans le Haut-Rhin.
PREMIÈRE ÉTAPE
Selon Jean-Yves Vogel, président de l'association de sauvegarde
et de mise en valeur du parc de Wesserling, ces votes de la COREPHAE sont une grande victoire.
« Après quatre ans de lutte, nous avons gagné la première manche », souligne-t-il, ajoutant
qu'il s'agit maintenant de passer à la deuxième étape, celle de la réhabilitation.
Jean-Yves
Vogel se dit sûr que le préfet de région suivra l'avis de la COREPHAE.
« Cette procédure bloquera
la démolition de la Barrette », se réjouit le président de l'association de sauvegarde. On sait
que la commune et le département veulent raser en partie le bâtiment le plus long du parc (120
mètres) et aménager le restant en logements sociaux.
L'association de sauvegarde a introduit
plusieurs recours devant le tribunal administratif contre le permis de démolition, et a obtenu
gain de cause pour le premier de ces recours. Elle a marqué jeudi un nouveau point.
(1)
Hasard du calendrier : le professeur Pierre Fluck visite cet après-midi le parc de Wesserling
avec ses élèves du DESS « Techniques et archives».
© Archives du Journal L'Alsace, 1999
|
|
 |
 |
| |
|
 Lors d'une réunion publique, l'Association de sauvegarde
et
de mise en valeur du parc a expliqué, les conséquences
sur le site d'un classement en monument
historique (Photo « L'ALSACE » - L.M.).
Lors d'une réunion publique, l'Association de sauvegarde
et
de mise en valeur du parc a expliqué, les conséquences
sur le site d'un classement en monument
historique (Photo « L'ALSACE » - L.M.).
Pierre Fluck, professeur d'archéologie industrielle à l'Université de Haute-Alsace
et spécialiste du patrimoine industriel, a retracé l'histoire du site depuis la mention de l'existence
d'un bâtiment appartenant aux princes abbés de Murbach au XVIIe siècle.
Il a décrit l'évolution
industrielle, sociale, culturelle du site, depuis la fondation de la première manufacture en
1762 par Sandherr, jusqu'à nos jours. Selon lui, le parc de Wesserling et ses bâtiments sont
le reflet fidèle de l'évolution manufacturière de l'Alsace et les témoins matériels d'un système
unique en France où les patrons maintenaient des relations sociales particulières avec leurs
ouvriers : aménagement de résidences ouvrières, ouverture d'une école sur le site, création
d'un théâtre, d'une ferme.
La deuxième partie de la réunion a été consacré aux événements récents
concernant l'avenir du parc. Une instance de protection et de mise en valeur du patrimoine,
la COREPHAE (Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et éthnographique)
s'est prononcé favorablement pour l'inscription et le classement du site. Le préfet de région
peut désormais prendre un avis de protection du parc au titre des monuments historiques.
MONUMENTS
HISTORIQUES
Les
membres de l'association ont expliqué au public les conséquences d'une inscription ou d'un classement.
En cas d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les monuments
sont protégés. Tous les travaux sur ces bâtiments doivent être soumis à l'avis du ministère
chargé des affaires culturelles. Cela concerne tous les habitants du parc, mais aussi tous les
riverains dans un périmètre de 500 mètres autour.
En cas de classement, les monuments concernés
ne pourront plus être détruits, leur transformation sera directement contrôlée par les services
de l'Etat qui intervient financièrement pour la réhabilitation et l'entretien. Dans un périmètre
de protection correspondant à un champ de visibilité de 500 mètres autour du site, toute construction,
restauration, destruction est soumise à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.
PLUS
ATTRACTIF
L'association souhaite ainsi rénover le site en le rendant plus vivant (tel l'Ecomusée
d'Ungersheim), plus attractif, en invitant la population locale à prendre une part active à
la réhabilitation de ce témoin du passé qui appartient à l'histoire et à la culture de la vallée.
Les
agriculteurs ont déjà mené une réflexion sur l'utilisation de l'ancienne ferme, en comptant
y stocker des animaux et en espérant y tenir un marché chaque semaine afin d'y vendre les produits
du terroir.
© Archives du Journal L'Alsace, 1999
|
|
 |
 |
| |
|
 L'inscription de l'ancien site industriel de Wesserling
à l'inventaire
des monuments historiques a été annoncée vendredi soir. L'inscription aux Monuments historiques concerne le parc de Wesserling dans
sa totalité et les mesures de protection touchent les bâtiments situés dans un périmètre de
500 mètres (Photo d'archives « L'ALSACE »).
L'inscription de l'ancien site industriel de Wesserling
à l'inventaire
des monuments historiques a été annoncée vendredi soir. L'inscription aux Monuments historiques concerne le parc de Wesserling dans
sa totalité et les mesures de protection touchent les bâtiments situés dans un périmètre de
500 mètres (Photo d'archives « L'ALSACE »).
L'annonce de Pierre Egler
a produit son effet, vendredi soir à Husseren-Wesserling, lors d'une réunion publique du candidat
aux élections cantonales à Saint-Amarin.
Le vice-président du conseil général et candidat à
sa propre succession a déclaré qu'il venait de recevoir une copie de l'arrêté portant inscription
à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques du parc de Wesserling, signé le 18 février
par le préfet de Région, Patrice Magnier, et envoyé au président du conseil général.
Le dossier
du Parc de Wesserling, propriété du Département, constitue un enjeu électoral et un point chaud
de la campagne.
Pierre Egler estime que l'inscription est « une catastrophe pour les communes
d'Husseren-Wesserling, de Ranspach et Fellering.
Toutes les demandes de permis de construire
faites dans le périmètre de protection devront être instruites par un architecte des Bâtiments
de France ».
DÉCEPTION
Opinion que partage d'ailleurs Bernard Steiger, maire d'Husseren-Wesserling
et directeur de campagne de la candidate socialiste, Graziella Stefana.
Il dénonce les « contraintes
architecturales découlant de l'inscription et applicables à toutes les habitations dans un périmètre
de 500 mètres autour du site. » Bernard Steiger se dit d'autant plus déçu qu'il avait remis
personnellement une lettre à Catherine Trautmann, le 13 février lors l'inauguration de la médiathèque
à Thann.
Dans sa missive, il expliquait au ministre de la culture qu'il n'était pas besoin d'une
inscription pour protéger le site et que celle-ci entraînerait « des contraintes administratives,
dans un secteur représentant le tiers de la surface de la commune ».
De son côté, François Tacquard,
opposant au conseiller sortant Pierre Egler, note que « face aux risques de démolition (ndlr
: le Département avait prévu de démolir une partie du bâtiment de la Barrette) et faute de mieux,
l'inscription permet de protéger le site ».
Il déclare qu'il faut « faire de cette contrainte
juridique un atout et un instrument de notoriété ».
Pour lui, cette inscription n'est que «
l'aboutissement d'une demande faite en 1989 par Jacqueline Winckler, maire d'Husseren-Wesserling
et Pierre Egler ».
Ce à quoi Bernard Steiger rétorque : « Ce qui était valable en 1989 ne l'est
plus en 1998 ».
© Archives du Journal L'Alsace, 1999
|
|
 |
 |
| |
|
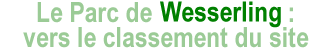 Inscrit depuis l'année dernière à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, le parc de Wesserling pourrait décrocher prochainement un label encore
plus contraignant et plus prestigieux. L'État propose le classement pur et simple de l'ensemble
du site.
Inscrit depuis l'année dernière à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, le parc de Wesserling pourrait décrocher prochainement un label encore
plus contraignant et plus prestigieux. L'État propose le classement pur et simple de l'ensemble
du site.
Le taux de subvention pour les monuments et sites classés est plus élevé que pour ceux
qui sont simplement « inscrits », mais les formalités sont plus longues. Un monument classé
dépend en effet directement du ministère de la culture, alors qu'un monument inscrit dépend
de l'architecte des bâtiments de France.
François Tacquard est favorable au classement, malgré
les contraintes supplémentaires. « Ce sera le plus grand site industriel classé de France »
souligne le conseiller général. « Il y gagnera une notoriété incomparable.»
Pierre Egler est
contre. « Nous serions des rigolos si nous demandions le classement après avoir refusé l'inscription.»
Le
président du district admet que le taux des subventions est élevé en cas de classement, mais
il souligne que l'État n'a pas suffisamment d'argent pour tous les monuments dont il a la responsabilité.
« Je crains qu'après un coup de pouce initial, il n'y ait plus rien pour Wesserling pendant
longtemps.»
François Tacquard ne partage pas ce pessimisme. « Le département du Haut-Rhin négocie
d'ores et déjà une enveloppe conséquente pour Wesserling, dans le cadre du prochain contrat
de plan. Nous aurons de quoi réhabiliter le château et la barrette.»
En réalité, le district
n'est concerné que pour deux bâtiments, qui lui appartiennent : le temple et le local du Club
vosgien. Le parc et le château sont la propriété du département du Haut-Rhin.
François Tacquard
admet que le classement du local du Club vosgien n'est pas indispensable. Mais il demande à
l'assemblée d'approuver celui du temple.
Proposition rejetée par 15 voix contre 25, et une abstention.
Le
vote est sans surprise, mais la sérénité du débat a singulièrement tranché avec les violentes
envolées des précédentes discussions sur le parc. Il y a bel et bien quelque chose de changé,
dans le royaume de Saint-Amarin...
Soulignons que le vote du district n'engage que lui. L'État
et le département du Haut-Rhin étant tous deux favorables au classement du site, celui-ci se
fera inéluctablement.
P.F.
© Archives du Journal L'Alsace, 1999
|
|
|

